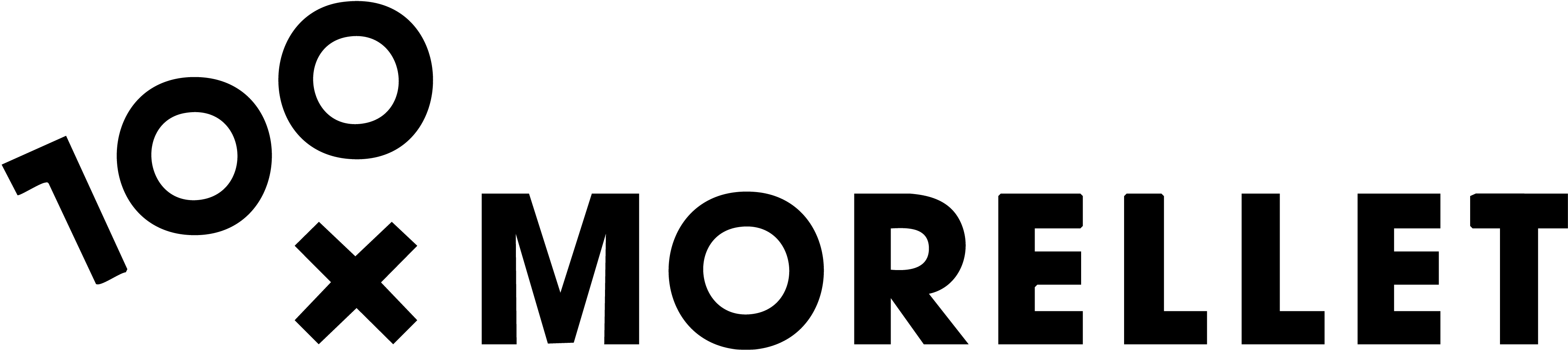Ligne de fuite : Entretien avec Alice Fleury (2007)
Alice Fleury Pourquoi avez-vous choisi le titre Ma musée ?
François Morellet J’ai toujours trouvé si bizarre que les langues européennes que je connais, mis à part l’anglais mettent des sexes à tous les objets. Et le comble, c’est quand on affuble d’un sexe masculin des mots qui se terminent par « ée », signe habituel de la féminité. Aussi, mon titre est pleinement justifié, car, d’un côté, il corrige une anomalie tout en donnant à « une musée » un air moins sévère, plus convivial, et d’autre part, évidemment, par un jeu de mot, pénible comme je les aime, il suggère l’amusement que me procure ma drôle d’activité. À ce sujet, je citerai la phrase favorite de Marcel Duchamp, d’après sa première femme : « Ce qui ne m’amuse pas ne m’intéresse pas ».
AL. Dans votre travail se croisent le constructivisme et Dada, c’est-à-dire une recherche d’absolue neutralité, de rigueur et de précision, et un aspect opposé qui relève du jeu, de l’humour, voire de la farce et de l’absurde.
Ici vous venez « chatouiller » le musée et la collection, ce qui est aussi souligné par le titre en forme de jeu de mot que vous avez choisi.
FM. J’ai toujours eu par mon éducation familiale le goût du jeu de mot, de la frivolité, de l’insignifiance. Mais je ne sais pas d’où je tiens mon penchant pour le contrôle et la précision. En fait, je ne suis pas doué pour les envolées romantiques et je garde pour moi les miasmes de mes profondeurs. Comme l’a écrit une historienne de l’art, je suis un « rigoureux rigolard ». C’est une anomalie bien française qui s’est épanouie à la fin du XIXe siècle dans les Salons des Incohérents où la seule contrainte exigée était d’être contre tous les « sérieux ». Alphonse Allais, que mon père adorait, y a exposé ses monochromes, le rouge par exemple étant Récolte de la tomate au coucher du soleil par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge.
Marcel Duchamp et, dans d’autres domaines, Alfred Jarry ou Erik Satie ont, ensuite, pris le relais. C’est là un résumé atrocement mutilant. Pour en savoir plus, il faut s’adresser aux Américains, tout au moins à ceux de l’université du New Jersey qui ont publié un ouvrage très sérieux sur notre manque de sérieux, à cette époque, qui s’intitule The Spirit of Montmartre. Les auteurs font remonter l’art contemporain et Dada en particulier à ce qui s’est passé à Paris après la guerre de 1870 ! J’appartiens donc à cette minorité de gens qui est à la fois fascinée par Mondrian et Picabia, tout comme je trouve fantastique le pessimisme de Cioran et son éloge de la frivolité.
J’adore le côté froid, systématique et absurde de Raymond Devos. Je pense à son texte où il raconte qu’il ne devait rien dire sur scène et que, finalement, il est relativement facile de ne rien dire. Ce qui est compliqué, dit-il, c’est de le faire savoir. Pour moi, c’est la même chose, ma peinture ne veut rien dire, mais j’ai du mal à le faire savoir.
Je me suis aussi beaucoup intéressé à l’Oulipo et particulièrement à Georges Perec qui a travaillé dans des directions proches des miennes. Dans La Vie mode d’emploi, il y a un personnage qui s’appelle Morellet, je pensais que c’était une coïncidence. J’ai été très ému quand j’ai appris que ce n’était pas un hasard, car tous les noms dans ce roman de Perec correspondent à des personnes précises.
AL. Depuis 1973 et les premiers tableaux « déstabilisés », c’est-à-dire les toiles de formats différents mises bout à bout et qui créent une forme accidentée se détachant sur le mur, vous avez donc commencé à travailler en trois dimensions et à prendre en compte l’espace environnant : ce qui est autour de l’œuvre est tout aussi important que ce qui est dans l’œuvre. Peut-on considérer que Ma musée se situe dans la suite de ces préoccupations ?
FM. Oui, bien sûr, et j’aurais aimé faire les deux expositions à Nantes — celle de 1973 et celle de 2007 — l’une à la suite de l’autre. Je trouve jolie l’idée d’envahir un musée sans que ça se voie. Par exemple, j’ai horreur des tringles qui sont utilisées pour accrocher les tableaux. Dans une salle du musée de Dijon (Présence discrète, Musée des Beaux-arts de Dijon, 1983) j’avais fait une intervention où le premier tableau avait deux tringles, le second trois, puis quatre et ainsi de suite.
AL. En 1991, invité à créer une œuvre originale pour la première biennale de Lyon, vous aviez déduit les modalités de votre intervention de la structure même de l’espace dont vous disposiez : une salle de 120 m2 fermée par des murs composés de panneaux fixés sur des échelles en bois. À partir de ces données et avec des matériaux identiques (échelles, panneaux, peinture blanche), vous avez proposé une pièce dans laquelle les murs du lieu d’exposition sont dédoublés et basculés. Dès le début des années 1970, il y a eu également les œuvres réalisées à partir de bandes d’adhésif.
Mises à part les œuvres de commande publique réalisées dans un contexte non muséal, vous vous intéressez depuis longtemps à la question de l’in situ dans l’espace du musée. C’est une dimension importante dans votre travail.
FM. Oui, car en fait il n’y a que dans les musées et les grandes expositions que l’on peut faire un grand travail in situ.
Je crois que c’est Harald Szeemann avec sa fameuse exposition de 1969, Quand les attitudes deviennent forme, qui a fait le premier des expositions avec des œuvres éphémères réalisées in situ. À Nantes, j’ai voulu faire une installation spécifique pour le musée et qui ne pourra pas être montrée ailleurs.
AL. On remarque donc dans cette œuvre une continuité tant par rapport à la question clé, l’in situ, que par la volonté de prendre en compte l’espace. Mais il y a aussi une autre dimension (qui est celle de l’autocitation).
Au Musée d’art moderne de la ville de Paris, vous avez présenté cette année une exposition pour laquelle vous avez choisi d’agrandir une série de toiles datées de 1952.
À Nantes, vous vous inspirez d’une toile réalisée en 1975 pour votre intervention. Est que l’autocitation est un élément nouveau dans votre travail ? Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette idée ? Est-ce une manière d’échapper à l’histoire de l’art et de ramener les œuvres vers une nouvelle actualité ?
FM. L’Œuvre que j’ai le plus « vampirisée » est une peinture très radicale que j’ai exécutée en 1953, Seize carrés. En 1964, j’en ai réalisé une copie en néon qui se reflétait dans l’eau noire d’un bac agité par le spectateur. En 1994, j’ai fait recopier par mon néoniste des dessins d’enfants qui avaient tenté de copier ce même tableau de 1953 (RÉCRÉATION no 1, d’après une œuvre de 1953 redessinée en 1994 par un enfant). Une autre fois, en 2002, j’ai fait recopier par le même néoniste les photos des reflets de 1964 (Après réflexion, 2002). En fait, pour ces œuvres nouvelles, il s’agissait plutôt d’une destruction ou tout au moins d’une perversion plutôt que d’une autocitation.
Les œuvres de 1952 que j’ai refaites en grand, c’est très différent. C’est un directeur de musée qui m’avait donné cette idée. Ces œuvres étaient faites pour être grandes, car elles sont all-over, répétitives, ouvertes. Quand elles vous enveloppent, c’est vraiment bien. Évidemment, il y a des œuvres qui ne gagnent pas à être grandes. Le charme du vide n’existe que dans les grands formats. C’est ce qu’ont découvert plus tard de grands artistes américains — Frank Stella, Donald Judd — très sévères par ailleurs envers tous ceux qui les ont précédés.
AL. C’est donc un pied de nez ?
FM. Oui, c’est parti d’un sentiment pas très honorable !
Pour un ouvrage sur Frank Stella en 1988, Alfred Pacquement avait reproduit certains de mes dessins préparatoires et d’autres de Stella dans le catalogue. C’est frappant de voir à quel point ces dessins se ressemblent.
Mais Stella avait seize ans en 1952, ce n’est donc pas étonnant qu’il n’ait pas pu le faire avant moi.
AL. Et à Nantes ?
FM. À Nantes, c’est particulièrement une œuvre pour les gens qui connaissent mon travail, pour mes « complices », comme dit Bertrand Lavier. J’ai envie de surprendre jusqu’au bout ces complices qui viendront, j’espère, encore une fois, voir quelle couillonnade j’ai bien pu faire. Ils pourront être un peu étonnés par les dimensions de mon « échappatoire » (25 x 25 m). C’est vrai, je n’ai pas un goût particulier pour les grandes œuvres. Mais ici, il s’agit d’une œuvre très légère, relativement facile à monter et à démonter. Elle sera la propriété du musée qui pourra stocker seulement les angles dans ses réserves. Oui, je n’aime pas vraiment, le grandiose. Je suis même devenu allergique aux pyramides et aux cathédrales. Je préfère Paul Klee à Fernand Léger ou Fred Sandback à Richard Serra.
Interview d’Alice Fleury pour le catalogue de l’exposition ma musée françois morellet, Nantes, Musée des Beaux-Arts de Nantes, 8 novembre 2007 – 4 février 2008.