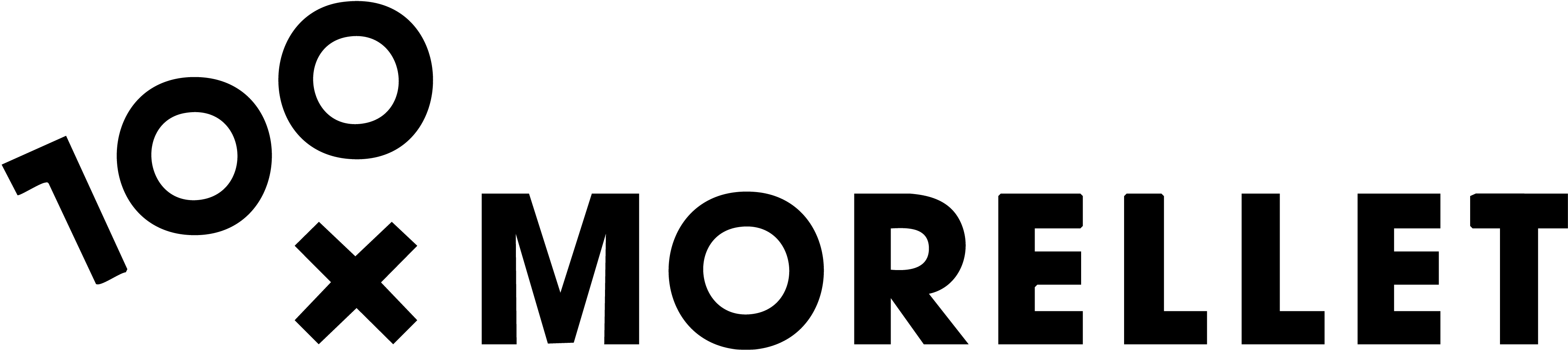François Morellet (peintre amateur) 1945-1968 (1997)
La petite provocation de ce titre ne doit pas cacher sa profonde vérité. Oui, au moins jusqu’en 1968, j’ai été un « peintre amateur Un vrai amateur, qui, dans le domaine de l’art, avait évité successivement (et plus ou moins volontairement) les professeurs, le professorat, et le professionnalisme.
Tout d’abord : les professeurs. J’ai, depuis toujours, eu des relations très difficiles avec ce que m’ont enseigné mes professeurs. Mes études dans le primaire, le secondaire, jusqu’à mon diplôme de russe, ont été cependant normalement banales et je n’ai pas eu d’antipathie exagérée envers les enseignants. Non, mon drame, mon infirmité, c’est de n’avoir jamais pu prendre du plaisir avec les matières que l’on m’enseignait. Les professeurs d’éducation religieuse, de littérature classique ou de judo, par exemple, m’ont enlevé jusqu’à aujourd’hui le goût pour ces différentes disciplines.
En revanche, par chance, je n’ai pas eu de professeurs d’éducation sexuelle, d’œnologie, de pêche sous-marine, et bien sûr… d’art un peu moderne.
Je suis donc entré dans l’art contemporain avec curiosité, en cheminant sans plan, de plaisirs en plaisirs, au hasard des œuvres rencontrées dans des musées, des galeries, des revues ou des livres d’art. Ces découvertes n’étaient pas toujours très nouvelles et ces amours très recommandables. Ce n’est pas vraiment valorisant aujourd’hui d’avoir aimé entre autres : Chapelain-Midy, André Marchand, Souverbie, Laprade, Gromaire, etc. Mais c’est peut-être intéressant de savoir, par exemple, que j’ai pu de cette manière découvrir très tôt une œuvre de Mondrian (dans un livre de Skira publié en 1947) alors que, quelques années avant, le professeur Fernand Léger « disait d’ailleurs très vaguement qu’il y avait bien des mouvements en provenance de l’Est, du Nord, de loin, mais qu’il ne fallait surtout pas entendre, ni écouter, ni voir, qu’ils étaient extrêmement dangereux, que c’était la mort de la peinture et qu’ils pouvaient même conduire jusqu’au suicide 1 ».
Entre Gromaire et Mondrian s’est glissée ma période « musée de l’Homme », où j’allais régulièrement au milieu de salles désertes, retrouver mes deux amours : les peintures sur écorce des aborigènes australiens et les merveilleux tapas océaniens. Mais je pense que, sans oublier Mondrian, les trois plus grands chocs qui ont déterminé une grande partie de mon œuvre jusqu’à aujourd’hui ont été : en 1950, la découverte de Max Bill à Rio de Janeiro, en 1952 celle de l’Alhambra à Grenade puis, vers 1956, celle des « duo-collages » que Sophie Taeuber et Jean Arp réalisèrent en 1918 « selon les lois du hasard ».
Au troisième de ces coups de cœur, j’avais trente ans et il était temps que je me mette à l’abri de nouveaux coups 2. Cela ne m’a pas empêché de continuer mon amateurisme, un amateurisme en groupe, cette fois avec le GRAV 3, dont le programme ludique, utopique, sans but lucratif a été un très bel exemple d’un nonprofessionnalisme conscient et organisé.
Enfin, sans parler vraiment de coups de cœur, je pense avoir été aussi au courant du Surréalisme, de Dada, de l’Art Brut, etc. Bien avant qu’ils ne soient « enseignés ». Oui, je crois qu’à mon époque, c’était une grande chance d’avoir appris l’art en amateur et d’avoir évité les écoles dont l’enseignement tuait le plaisir et ignorait la modernité.
Avec cette formation et cette mentalité, on comprendra bien que le professorat m’ait été interdit aussi bien par les professeurs, que par moi-même.
Je passe donc directement au professionnalisme qui, je dois l’avouer, m’a évité sans que je le veuille vraiment. Est-ce ma position de peintre amateur provincial ou la radicalité de mes œuvres (à partir de 1952) qui a empêché galeries et collectionneurs français de s’intéresser à mon travail ? Je ne le sais pas, mais je suis sûr que cette absence continue d’intérêt, en me libérant de toute contrainte commerciale, m’a permis de m’adonner sans réserve à mes jusqu’au-boutismes des années cinquante et soixante.
De toute façon, cette non-commercialisation de mes œuvres (pas plus de vingt œuvres vendues en vingt ans) a amené un autre signe distinctif de l’amateurisme : la présence nécessaire et envahissante d’un « premier métier ».
Les artistes professionnels, eux, peuvent avoir une autre occupation, mais c’est alors un « second métier » discret et souvent valorisant (professeur d’art par exemple).
Le « premier métier » de l’amateur, s’il lui permet en général de vivre, sans trop d’angoisse, sur le plan économique, l’exclut pratiquement de la « communauté artistique ». Ainsi, surtout s’il est provincial, il ne pourra assister à ces vernissages, ces réunions d’artistes, dont il rêve et qu’il idéalise d’autant plus qu’il n’en connaît pas les dessous.
Et si plus tard, par chance, l’amateur devient professionnel à part entière (cela m’est arrivé à cinquante ans), on le remarquera encore parmi les vrais professionnels (blasés, révoltés, écorchés vifs, etc.) par son air indécent d’amateur incorrigible.
Publié dans François Morellet (peintre amateur) 1945-1968 (cat. d’exp.), Angers, Musée des beaux-arts, 2 juillet-12 octobre 1997, pp. 9-11.
1 Interview d’Aurélie Nemours par Henri-François Debailleux, Libération, 30/08/1996.
2 Des « découvertes jubilatoires », j’en aurai eu heureusement d’autres dans ma vie d’artiste professionnel (que je fais commencer dans les années 1970), mais elles auront eu, je crois, peu d’influence sur mon travail, si ce n’est à la fin des années 1980, celle du baroque tardif de Bavière.
3 Le Groupe de Recherche d’Art Visuel a eu de 1961 à 1968 pour membres : Julio Le Parc, Horacio Garcia Rossi, Francisco Sobrino, Joël Stein, Jean-Pierre Yvaral et moi-même.