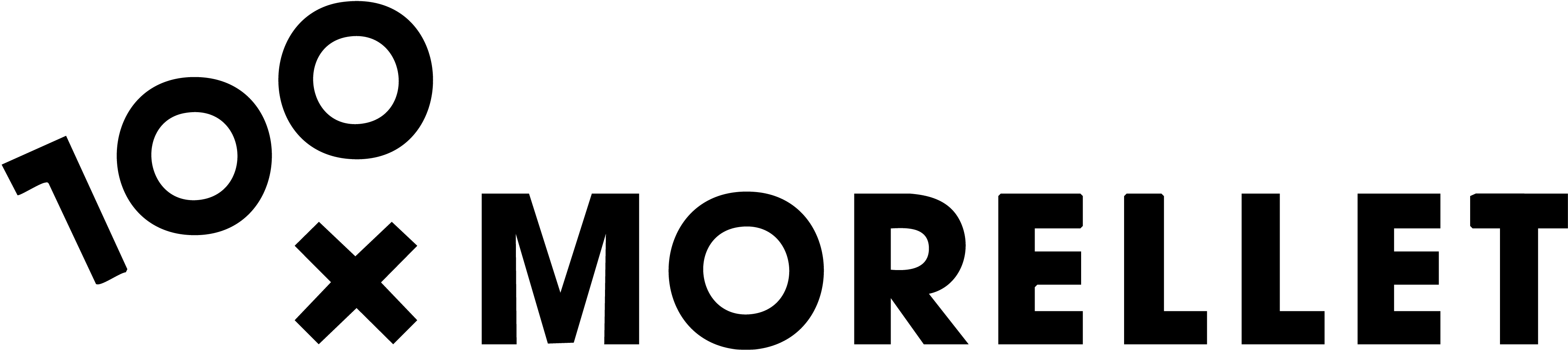Une conversation entre Benjamin H. D. Buchloh, François Morellet et Danielle Morellet (1987)
Benjamin H. D. Buchloh Quelle a été votre formation artistique et que connaissiez-vous de l’histoire de l’art lorsque vous avez commencé à travailler ?
François Morellet Pour la parcourir très rapidement, dans les années 40, j’ai commencé par la peinture figurative, mais sans jamais avoir eu de professeur. C’était vraiment plus le plaisir d’être peintre. J’avais voulu en être un, peut-être parce que mon père avait un peu surestimé les peintres. Il n’aimait pas tellement la peinture, mais il aimait les peintres et aurait aimé en être un. Quand j’ai fait ma première toile, j’ai mis beaucoup de peinture sur mon short pour ressembler à un peintre ; cela semblait important. Je l’apprécie toujours, mais je me rends compte qu’à cette époque, je devais avoir une idée un peu romantique de la profession.
J’étais contre les musées parce que j’avais lu partout que les musées étaient des temples, qu’il fallait les brûler. Mais j’ai adoré le Musée de l’Homme et j’ai été très influencé par tout ce que j’y ai vu, notamment l’art océanien et les tapas imprimés de motifs abstraits. J’y ai passé beaucoup de temps. C’était à la fin des années 40. Je faisais pratiquement du faux-océanique, et je suis toujours heureux chaque fois que je vois ces tapas. Puis au début des années 50, j’ai dû aborder l’abstraction sous l’influence de l’École de Paris.
Buchloh Au début de votre carrière, avez-vous répondu aux avant-gardes, notamment aux constructivistes russes de 1915 à 1925 ? À la fin des années 40, Piet Mondrian ou Kazimir Malevich faisaient-ils partie de vos influences ?
F. Morellet Non, pas du tout. L’influence de Katarzyna Kobro, Alexander Rodchenko et le reste a été beaucoup plus tardive. A cette époque, j’ai été influencé en quelque sorte par Alfred Manessier, Maria Helena Vieira da Silva et Serge Charchoune, un peintre que j’aime toujours. Vers 1950, j’ai réalisé mes premières peintures abstraites. Il s’agissait de lignes plus ou moins horizontales et plus ou moins verticales, qui donnaient une sorte de damier, une construction à compléter au fur et à mesure, un peu à la manière de Paul Klee ou de certains artistes de l’Ecole de Paris. Puis je suis rapidement arrivé à quelque chose de beaucoup plus simple. En 1951, par exemple, j’ai réalisé un petit tableau dont la surface est divisée en deux par une diagonale, ne laissant apparaître qu’un côté blanc et un côté gris.
Buchloh La tradition plus locale de l’abstraction réductrice comme celle de Victor Vasarely ou d’Auguste Herbin a-t-elle été aussi une influence ?
F. Morellet A cette époque, Vasarely peignait d’une manière très École de Paris ; il est finalement arrivé à la réduction, au noir et blanc, vers la fin des années 1950. Quand je l’ai rencontré, il me semblait que j’étais allé plus loin que lui. À l’époque, il fabriquait de grandes formes colorées ; elles étaient jolies mais manquaient de système ou de construction.
Buchloh et Josef Albers ?
F. Morellet Non, mais il y a eu un très grand événement pour moi à l’époque. En 1950, nous voulions émigrer au Brésil parce que nous ne croyions plus en l’Europe. Quand nous y sommes arrivés en 1950 ou 1951, Max Bill venait de monter une grande exposition, et j’ai rencontré des artistes qui m’ont montré de mauvaises photos de journaux en noir et blanc de cette exposition.
Buchloh Il vous a fallu aller au Brésil pour découvrir Max Bill ? C’est un fantastique paradoxe.
F. Morellet C’est étrange, non ? Je faisais déjà un travail abstrait qui était assez simple, mais ce n’était pas encore justifié, Concret. Ces images de Bill ont été une révélation, et c’est ainsi que j’ai connu Albers. À l’époque, Bill créait la Hochschule für Gestaltung à Ulm, en Allemagne, et j’y ai rencontré pas mal d’artistes. L’artiste brésilien Almir Mavignier, qui était venu en France sans doute en 1951, juste après mon retour du Brésil, est allé étudier à Ulm. C’est lui qui m’y a emmené pour la première fois. À Paris, vers 1953-54, il m’a également présenté à Ellsworth Kelly, qui était en Europe à cette époque. Nous avons rencontré Bill à plusieurs reprises. Ce que j’aimais chez lui, c’était son côté conceptuel, concret, qui rejoignait le principe de Theo van Doesburg selon lequel une œuvre doit être conçue avant d’être exécutée ; une œuvre doit être justifiée.
Mes deux grandes influences ont été l’art concret, que j’ai découvert grâce à Bill, et l’art islamique, à travers les arabesques des motifs mauresques de l’Alhambra de Grenade, en Espagne. Si vous branchez les deux dans l’ordinateur, cela vous donnera probablement beaucoup de choses que j’ai faites dans les années 1950.
Nous avons consulté les carnets de Danielle pour voir si mes premières trames avaient été réalisés avant ou après la visite de l’Alhambra. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’une influence directe, mais j’ai ensuite réalisé que j’avais déjà exécuté des trames de motifs uniformément répartis avant notre voyage de 1952. Mais peu importe, l’Alhambra a été une énorme révélation. L’art concret que j’avais découvert avec Bill avait ses aspects systématiques. Tout à coup, avec l’Alhambra, ce all-over m’a semblé étonnant, infini.
Buchloh Vous avez rencontré Kelly vers 1953. Avez-vous vu sa célèbre exposition en 1951 à la Galerie Arnaud ? Vous viviez à Paris à cette époque ?
F. Morellet Non, j’ai étudié à Paris mais je n’y vivais pas. J’ai rencontré Kelly et puis, bien sûr, j’ai vu certaines de ses expositions, comme celle de la Galerie Maeght par exemple.
Buchloh Aviez-vous une certaine amitié avec Kelly à l’époque ?
F. Morellet Oui. Finalement, il a vécu chez mes parents dans une petite pièce au-dessus de leur appartement. À Paris, il y avait un autre type merveilleux, qui faisait des peintures très minimalistes, Jack Youngerman. Et Alain Naudé. Nous étions tous amis.
Le travail de Bill a été un choc pour moi et je pense pour Kelly aussi. Il avait rendu visite à Bill à plusieurs reprises et m’en avait parlé, mais je ne pense pas que cela apparaisse dans la littérature sur Kelly.
Buchloh C’est toujours Jean Arp et Joan Mir., qui sont mentionnés.
F. Morellet Kelly ne m’a pas parlé d’Arp, sauf peut-être des choses qu’il a faites avec Sophie Taeuber-Arp en rapport avec le hasard.
Je ne rencontrais pas beaucoup de gens à cette époque. Nous allions à Paris certains week-ends ; nous dînions avec Kelly, Youngerman et Naudé. Mais je n’avais pas l’occasion, comme un certain nombre d’artistes, d’étudier à l’Ecole des beaux-arts, d’avoir du temps libre, de parler, de rencontrer d’autres artistes. Je n’ai jamais rendu visite à Arp. J’ai rendu visite à Georges Vantongerloo deux fois parce que Bill, qui a été très influencé par lui, m’a dit de le faire. Ce sont mes contacts, mais revenons au grand maître Mondrian. Serge Lemoine m’a dit que la première reproduction de son œuvre publiée en France l’a été dans un livre de Skira sorti trois ans après la mort de Mondrian. Il n’y avait pas un seul Malevitch et certainement pas un Rodchenko ou un Kobro. Je me souviens avoir ouvert ce livre et découvert cette reproduction de Mondrian. Cela devait être vers 1950. Ça m’a énervé. « Pourquoi être si agressif ? » Je me suis demandé. Mais je revenais toujours au livre. Il me fascinait et m’agaçait en même temps. Une fois l’agacement passé, et grâce à Bill, qui m’avait servi de tremplin, j’ai vécu une grande histoire d’amour avec Mondrian. En même temps, il y avait la fascination pour Marcel Duchamp, qui n’était pas très connu en France à cette époque.
J’étais ami avec Joël Stein, que j’ai rencontré à Paris et qui faisait partie du Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV). C’était un type formidable, très littéraire. Il avait assisté à des réunions et avait été quelque peu impliqué dans le groupe surréaliste. C’est lui qui m’a présenté Duchamp. J’étais fasciné et excité par l’irritation que l’attitude de Duchamp pouvait déclencher. J’aimais le contraste, et tout en m’identifiant à Mondrian, j’ai continué à être fasciné par Duchamp.
Buchloh Qu’en est-il des artistes du groupe Abstraction-Création à Paris à cette époque ?
F. Morellet C’est drôle parce que dans les années 1950, il y avait beaucoup d’art géométrique, notamment au Salon des réalités nouvelles. Puis un certain nombre d’artistes, comme Youngerman et d’autres, ont changé leur pratique. Il y a eu une vitalité au début des années 1950 avant que certains artistes n’abandonnent faute de succès (le succès a plutôt honoré la peinture de l’Art Informel).
L’année 1952 est peut-être celle où j’ai réalisé le plus d’œuvres qui continuent à m’intéresser, la plupart d’entre elles ayant très peu, voire pas du tout, de composition. Des peintures uniformément réparties, s’inspirant quelque peu de l’esprit du monochrome, contenant des éléments tels que des rayures, des trames, des choses répétées, un peu comme la musique répétitive que j’ai rencontrée beaucoup plus tard. La musique sérielle m’avait toujours ennuyé (à l’époque, j’étais passionné de jazz). Elle ne m’a enthousiasmé que beaucoup plus tard, avec Steve Reich. J’étais un tel champion de la peinture uniformément répartie que lorsque j’ai vu les œuvres de Barnett Newman, par exemple, zéro ! Elles n’ont rien fait pour moi ! Pour moi, Newman était le summum de la composition, de l’arbitraire. En revanche, les Pollocks que j’avais vus à la galerie Paul Facchetti étaient beaucoup plus proches de ce qui m’intéressait.
Buchloh J’ai vu une de vos peintures de 1958 au troisième étage de votre maison qui m’a énormément frappé. Je n’avais jamais vu d’œuvres de cette période. Cela m’a intéressé parce que j’ai tout de suite pensé qu’il y avait un vrai dialogue avec l’œuvre de Jackson Pollock ou que cela pouvait même représenter une réponse à son œuvre.
F. Morellet Vasarely l’a très bien dit : Vous avez effectivement fait du Tachisme sans vous salir les doigts. C’était exactement cela.
Buchloh Était-ce une réponse à Pollock d’une certaine manière ?
F. Morellet Non. Peut-être. En 1952, j’étais amoureux de Mondrian (j’ai dû commencer à l’aimer en 1950). Mais pour moi, il n’est pas allé jusqu’au bout. Ce qui reste traditionnel chez Mondrian, c’est la composition.
Buchloh Au lieu de la composition, ce qui vous intéressait, c’était les principes, les séries, la répétition, un système objectif ?
F. Morellet Oui, et surtout le moins de décisions subjectives possible. Le tableau que j’aime le plus est de 1953, un carré blanc dans lequel trois lignes verticales et trois lignes horizontales forment seize carrés.
Buchloh C’est la trame parfaite.
Morellet La trame parfaite. Le bord du tableau remplaçant la ligne, il forme seize carrés. C’est satisfaisant parce que c’était aller contre Mondrian, plus loin que Mondrian, contre l’Ecole de Paris, contre tout ce qui se passait à cette époque.
Buchloh Que pensez-vous du célèbre argument de Frank Stella sur la peinture relationnelle, autrement dit la peinture de composition ? Il affirmait que toute la peinture européenne adhérait à la composition, avec un équilibre entre poids et contrepoids, comme dans le cas de Mondrian. Et Stella, dans sa célèbre interview de 1966, déclarait qu’il avait, avec ses peintures noires de 1959, rompu avec cette tradition de la peinture relationnelle.1 Évidemment, il faut un certain culot pour dire cela.
F. Morellet Oui. Pour moi, Stella est toujours un grand personnage, il a fait beaucoup de choses. C’était un bon ami de Kelly, qui avait d’ailleurs des reproductions de mon travail et qui voulait me présenter à Stella. Vers 1954, j’ai réalisé des peintures aux angles concentriques, un motif que Stella a rapidement privilégié. À quatre ou cinq ans d’intervalle, nos peintures se ressemblaient beaucoup.
Buchloh Quoi qu’il en soit, ce sont des questions auxquelles toute une génération d’artistes était confrontée, et inévitablement, certaines solutions et réponses peuvent être similaires.
F. Morellet Oui, bien sûr. Mais si vous avez eu le malheur de faire ce qu’un Américain avait déjà fait, vous allez en entendre parler ; mais quand cela se produit dans le sens inverse ! J’ai vécu la même chose avec Sol LeWitt…
Buchloh Oui, je voulais éviter ce sujet parce que c’est une vieille histoire.
F. Morellet Oui, c’est une vieille histoire, lancée par ma galerie en Allemagne, accompagnée d’une promotion un peu lourde. Mais aux Etats-Unis, cela m’a apporté plus de problèmes que d’avantages. En tout cas, ce qui est certain, c’est que lorsque vous avancez dans une trajectoire, il peut arriver que d’autres soient arrivés au même point. Cela m’est aussi arrivé dans l’autre sens, de faire des choses après d’autres, de m’en rendre compte et de revenir en arrière.
Lorsque Du jaune au violet (1956) a été exposé dans une foire par la Galerie M, le marchand de la galerie allemande de Stella l’a pris pour un Stella. La même situation m’est arrivée avec le LeWitt que j’ai vu dans Flash Art ; j’ai cru que c’était une de mes peintures.
Buchloh Pour en revenir aux principes de votre travail, dans quelle mesure Duchamp vous a-t-il influencé ? J’imagine que vous avez dû être intéressé par sa redéfinition de la distance ou de la ligne ?
F. Morellet C’est vrai, la distance, mais aussi l’espèce de mythe qui a commencé à prendre forme autour de Duchamp alors qu’il n’y avait pas encore beaucoup d’articles approfondis sur lui et peu de reproductions. Jan van der Marck a été le premier à écrire sur cette relation monstrueuse entre Mondrian et Van Doesburg d’une part, et Duchamp et Francis Picabia d’autre part.
Comme cela a commencé à être mentionné à l’époque et comme cela continue à l’être – et cela me fait vraiment plaisir – je pense que je n’ai jamais été vraiment sérieux. Quand j’ai fait mon arc de cercle brisé en 1954, c’était aussi pour choquer, pour me distancer de la géométrie et du constructivisme. Quand j’ai fait ces tableaux entièrement distribués avec des trames, des répétitions, c’était aussi un moyen de réagir contre le constructivisme et Mondrian. Lorsque j’ai fait des peintures aléatoires de distributions uniformes de 40 000 carrés ou de lignes aléatoires, c’était une parodie, une prise de position ironique.
Présenter une simple ligne brisée en quatre comme ça, c’était autant du Picabia et du Duchamp que du Mondrian. J’ai découvert Van Doesburg bien plus tard. J’aimais tellement Mondrian au début que j’ai pris parti contre Van Doesburg, et un jour, j’ai réalisé que je lui ressemblais, pas à Mondrian.
Buchloh Étiez-vous ami avec certains artistes issus du Nouveau Réalisme ?
F. Morellet Non, pas du tout. Je n’ai rencontré Daniel Spoerri que très tard et Arman, encore plus tard. Et Yves Klein, bien sûr. Les premières choses que j’ai vues… et son attitude, tout m’a quelque peu fasciné.
Buchloh Et Ad Reinhardt, par exemple, avez-vous vu son exposition à Paris à la Galerie Iris Clert ? C’était en 1954.
F. Morellet J’ai vu beaucoup de Reinhardt à cette époque – il était dans beaucoup d’expositions – mais je n’en ai pas fait grand cas.
Buchloh Vraiment ? Malgré son principe de non-composition ? Parce qu’il y a moins de composition dans son travail que dans celui de Newman.
F. Morellet Pas tant que ça. J’ai vu une délicatesse que j’ai trouvée jolie et moderne, mais….
Buchloh Mais dans son œuvre le principe de sérialité se voulait un principe qui tendait à abolir la composition.
F. Morellet Oui, bien sûr, complètement. Et Malevitch m’a toujours ennuyé par exemple, et encore aujourd’hui….
Buchloh Quand l’avez-vous finalement découvert ?
F. Morellet Je ne l’ai jamais découvert parce que découvrir, c’est apprécier. Mondrian, par exemple, m’a d’abord ennuyé, dans les années 1949-50 ; ensuite j’ai aimé son œuvre.
Après le départ de Youngerman, Naudé et Kelly, je me suis retrouvé tout seul. Vers 1959, un groupe d’artistes sud-américains est arrivé, et entre-temps, nous sommes entrés en contact avec des gens assez merveilleux, des hongrois du nom de Molnàr. Nous avons donc décidé de former un groupe avec certains de ces Sud-Américains, qui étaient entre-temps allés voir Vasarely. Le groupe a pris sa forme stable avec six personnes, trois Sud-Américains et trois Européens : Horacio García Rossi, Francisco Sobrino, Julio Le Parc, et Yvaral (le fils de Vasarely), Stein et moi. Nous avons tous pratiquement cessé de peindre au cours de ces années.
De 1960 à 1968, nous avons joué avec beaucoup de labyrinthes, notamment un grand pour la Biennale de Paris en 1963. Les gens entraient dans des » pénétrables « , comme Jesús Rafael Soto les a appelés plus tard. Il y avait une salle entière avec 40 000 carrés aléatoires rouges et bleus sur les murs et le plafond. L’installation se terminait par une salle avec quatre panneaux de néons qui se faisaient écho les uns aux autres et entouraient les spectateurs.
Nous nous concentrions sur la participation du spectateur. En 1962, j’avais réalisé ma sphère ; en 1963, j’ai commencé à travailler avec des néons. Il y avait eu une sorte de parenthèse, où nous pensions que la peinture était terminée et qu’il était maintenant nécessaire de faire participer le spectateur, que c’était la société du futur.
Buchloh Il est vraiment intéressant de comprendre que votre position à la fin des années 1950 et au début des années 1960 était très spécifique, car elle était différente à la fois de la tradition cubiste dite géométrique ou abstraite et de la pratique des Nouveaux Réalistes, qui se référait à Duchamp. Votre position se référait à Duchamp et Mondrian de la même manière mais s’efforçait de s’éloigner des deux et à transformer tous ces paradigmes d’avant-garde, mais dans un espace qui semble aujourd’hui plutôt complexe et isolé.
F. Morellet Oui, on pourrait le résumer comme le fils monstrueux de deux héritages distincts. Finalement, j’ai en moi ce puritanisme constructiviste. Les artistes concrets, les constructivistes, les minimalistes, De Stijl, ce sont tous des moralistes, des puritains, des jansénistes en fait. J’ai ce côté coincé et j’aime cette rigueur, mais j’ai aussi un très fort penchant pour l’absurde et le dynamisme.
Buchloh En ce qui concerne ces deux postures – pour simplifier, une position duchampienne et une position réductiviste, utopique – quelqu’un comme Piero Manzoni vous a-t-il intéressé ? Parce qu’il a essayé de relier ces deux positions de la même manière.
F. Morellet Oui. Le premier tableau que j’ai vendu l’a été par une galerie appelée Azimut à Milan, fondée par Enrico Castellani et Manzoni. Ils m’ont invité à faire une exposition en 1960. Le groupe autour de la galerie n’était pas encore formé. Il y avait des peintures de Castellani, des monochromes de Klein et aussi de Lucio Fontana. Azimut a duré deux ans. Je crois qu’ils ont été les premiers à exposer Jasper Johns en Europe.
Manzoni est venu acheter une de mes peintures, une trame très chargée, un peu tachiste. Mais bien sûr, Manzoni ne m’a jamais envoyé l’argent. Finalement, plus tard, il nous a envoyé deux de ses « boîtes de merde », qui valaient à peu près autant que le tableau en prix. 3
Buchloh Une autre question devrait être soulevée en ce qui concerne les artistes des années 1950 qui ont amené l’art au niveau du pur spectacle, par exemple Klein et d’autres issus du Nouveau Réalisme. Cette dimension de pur spectacle et de provocation est absente dans votre travail, qui est beaucoup plus équilibré.
F. Morellet Plus coincé. Vous connaissez le mot « coincé » ? Je crois que j’ai un faible pour les artistes qui ne sont pas coincés. Les Nouveaux Réalistes – Jean Tinguely, Klein, Arman, César Baldaccini, Spoerri – ont fait de très bonnes choses à une époque, pendant la grande période de l’après-guerre. Mais Spoerri et Tinguely n’avaient pas du tout ce côté un peu huguenot, un peu coincé, que j’ai l’impression d’avoir. Ils étaient constamment dans l’escalade, Pierre Restany les a réunis, et ils ont travaillé les uns avec les autres. Quant à moi, j’étais le petit provincial, complètement isolée du monde. Je ne pouvais pas vraiment faire des choses scandaleuses dans mon atelier à Cholet ou à Clisson où j’étais avant.
Quant à ces merveilleux artistes russes dont nous parlions, j’étais tellement désolé quand j’ai vu combien de temps il fallait pour les connaître, pour apprendre que Rodchenko avait fait ces trois monochromes. J’ai appris tout cela plus tard, et c’est regrettable, mais le résultat est que, même si j’adorais Mondrian, je pense que De Stijl a été quelque peu surévalué par rapport au constructivisme. De même, un type très sous-estimé, qui m’intéresse davantage aujourd’hui, précisément parce qu’il n’a pas été autant promu, est Bart van der Leck, qui a été éclipsé.
Buchloh Vous avez également adopté une position critique, j’imagine, en ce qui concerne votre relation avec les avant-gardes des années 1920. Par exemple, l’esprit utopique, l’espoir concrétisé dans l’œuvre de Mondrian, n’était alors plus possible. Il n’y avait plus d’objectifs sociaux associés à l’abstraction pour votre génération. Y avait-il une sorte de scepticisme qui motivait l’évolution de votre travail ?
F. Morellet Pendant plusieurs années, j’ai eu un peu honte de mon scepticisme. Il a dû augmenter progressivement, mais au début, j’étais encore dans l’idéalisme des années 1920.
Buchloh Oui, il y avait donc un modèle utopique au début ?
F. Morellet Oui, au début. Mais quand j’ai fait les trois lignes horizontales croisant les trois lignes verticales, j’ai senti que je lançais une sorte de provocation.
Buchloh C’était aussi une façon de concevoir un modèle d’égalité ?
F. Morellet Il y avait un côté mystique, au sens large du terme. Il y avait une provocation, bien sûr, mais elle n’était pour personne puisque je n’exposais pas encore, même si j’avais dans l’idée qu’un jour quelqu’un la verrait. Mais je cherchais une forme de pureté, un mot qui aujourd’hui m’horrifie – je le trouve même dangereux. (Si un politicien le prononce, je vais me précipiter dans le pays d’à côté.) J’ai été séduit par l’idéalisme un peu bête de Mondrian, mais le scepticisme est venu très vite. Chaque année, la proportion de tableaux sceptiques augmentait, dès 1954, avec l’arc fragmenté par exemple. Ce n’était plus mystique.
Buchloh Mais ce n’était pas drôle non plus, c’était une sorte de perversion du problème. Cela restait sérieux. Ce n’était pas la ligne telle que définie par Manzoni, par exemple.
Danielle Morellet Puis, à partir de 1958, il y a eu toutes les répartitions réalisées avec le hasard, une vraie percée grâce à l’humour.
F. Morellet Oui. Kelly avait déjà fait ce genre de choses, pas dans l’esprit dadaïste, et les Arp l’avaient déjà fait dans l’esprit dadaïste. Il peut y avoir une mystique du hasard. Par exemple, le Hollandais Herman de Vries, dont j’aimais beaucoup l’œuvre, ne travaillait pas avec le hasard mais avec une mystique du hasard. Dans mon travail, l’utilisation du hasard n’avait rien de mystique, il s’agissait plutôt de montrer que l’utilisation du hasard était la règle du jeu.
D. Morellet C’est bien sûr là où LeWitt s’est retrouvé huit ans plus tard.
Buchloh Oui, et j’aimerais revenir sur cette extraordinaire peinture que vous avez réalisée chez vous en 1958. J’avais l’impression qu’elle n’était ni cynique ni utopique, mais presque un peu sceptique.
F. Morellet Nihiliste.
Buchloh Oui, un peu. S’éloignant à la fois de l’abstraction et de la sérialité. C’est une attitude extrêmement critique mais qui se déroule dans un espace totalement neutre. C’est vraiment difficile à expliquer. Ce n’est pas désespéré ; c’est une négation de l’expression…
F. Morellet C’est un peu l’esprit de Robert Ryman pour moi, de remplir une surface comme ça.
Buchloh Ce tableau m’a frappé parce que je ne l’avais jamais vu auparavant, et sa radicalité m’a frappé. Il y a une qualité que je trouve chez Manzoni, même si ce n’est pas toujours drôle ou dadaïste. Mais dans certaines de ses œuvres, il y a cette sorte d’objectivité neutre ; c’est presque positiviste.
F. Morellet Oui, un peu. Il serait préférable de parler d’absurde, plutôt que d’humour, avec mon travail. J’aime l’ordre et l’absurde, mais surtout pas comme des qualités séparées. Les choses que j’ai toujours le plus aimées – par exemple ce film de Fischli et Weiss – sont généralement très construites, très ordonnées dans leur succession, et complètement absurdes. L’ordre et l’absurde : cela peut avoir un côté nihiliste, parce que c’est tragique, et cela peut aussi avoir un côté comique…
Buchloh Est-ce que ça peut aussi avoir un côté mécanique ? Il y a aussi un jeu avec le mécanisme du dessin dans cette œuvre. C’est un anonymat presque complet, et en même temps, il conserve une structure et une conception qui résiste à l’anonymat complet.
F. Morellet J’ai cette théorie que les artistes sont là pour préparer le terrain afin que les spectateurs puissent y déballer leur pique-nique. Ce n’est pas une idée très novatrice, mais je pense que ce que le spectateur trouve dans l’art, c’est ce qu’il y apporte. Pour moi, afin que les spectateurs puissent déballer le plus grand pique-nique possible, j’en mets le moins possible. Je recherche une neutralité, ou une pauvreté, afin de recevoir une certaine forme de richesse de la part du spectateur. C’est comme quand j’écoute Steve Reich. Il n’y a rien, et c’est pourquoi je peux y entrer. Ce penchant pour le vide est une sensibilité, je pense, qui appartient au vingtième siècle, et peut-être au Japon à d’autres époques. En fin de compte, en ce qui concerne de nombreuses pièces que j’ai réalisées, il faut parler de l’absurde et de l’humour, mais aussi d’un penchant pour le vide.
J’ai toujours aimé Ryman. Je trouve qu’il caractérise très bien le genre de neutralité qui vire au « rien du tout » avec un certain raffinement et toujours sans drame. C’est un « rien du tout » qui sourit et qui est complètement vide en même temps. Pour moi, mes trois lignes horizontales qui croisent mes trois autres lignes verticales, c’est la même chose ; ce vide permet de dire : « Oh, ouf, il n’y a rien, mais c’est quand même très agréable qu’il n’y ait rien » – voilà.
1 Frank Stella, cité dans Bruce Glaser, « Questions to Stella and Judd », ARTnews (septembre 1966), repris dans Minimal Art : A Critical Anthology, ed. Gregory Battcock (New York : Dutton, 1968), pp. 148-64. 2 Pour en savoir plus, voir « The Rigorous Absurd : Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, and Béatrice Gross in Conversation », dans ce volume, pp. 27-28 ; Flash Art, no. 39 (février 1973), p. 33. 3 Lucio Fontana avait acheté le tableau de Morellet, puis Manzoni avait offert sa propre œuvre à Morellet au lieu du paiement de Fontana.
Traduit par Molly Stevens. © Dia Art Foundation. Traduction anglaise publiée à l’origine dans Béatrice Gross avec Stephen Hoban, eds., François Morellet (New York : Dia Art Foundation, 2019), p. 207-212. Réalisée à l’origine en 1987 chez les Morellet à Cholet, France, cette conversation a été traduite, condensée et éditée pour cette publication.