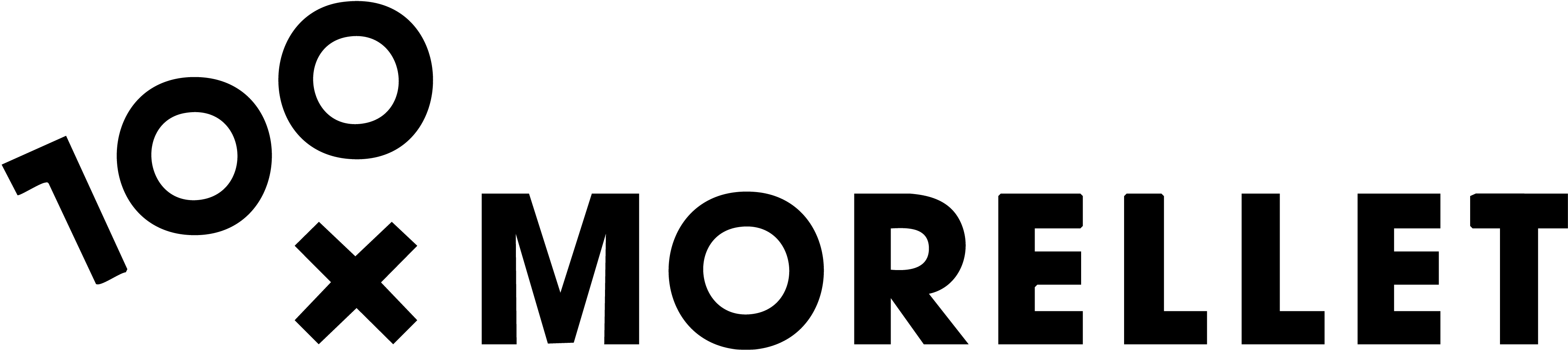L’exposition à la galerie Raymond Creuze en 1950 (2014)
Avant-propos
N’ayant pu trouver d’historien de l’art vivant qui ait pu être témoin de la scène artistique en cette fin de demi-siècle à Paris, il ne me restait plus qu’à me pencher sur ce lointain passé, position qui m’est familière aujourd’hui.
Mais si vous désirez plus de détails et de précisions vous les trouverez dans l’excellente monographie d’un historien, pas vraiment témoin étant donné son jeune âge, Serge Lemoine, éditions Flammarion 2011.
L’exposition de 1950
Raymond Creuze, qui m’avait invité à exposer dans sa galerie en 1950, était un type très sympathique et passionné. Un des artistes qu’il défendait, sans défaillir, était Charchoune, que j’aime beaucoup. Sa galerie était très bien située, avenue de Messine, près de la galerie Carré. Kenneth Noland, un an avant moi, y avait lui aussi fait sa première exposition. C’était une des galeries les plus actives de Paris. Je montrais alors 33 des œuvres réalisées l’année précédente en 1949. Sur le mini catalogue de l’invitation j’avais donné des titres aux 33 œuvres exposées dont je ne trouve aujourd’hui aucune trace même derrière les œuvres. On devra donc les oublier maintenant. On avait aussi édité une petite affiche incomplète que je devais compléter à la main sur chaque exemplaire.
J’ai reçu 13 coupures de presse, dont une pour l’Italie et une autre pour la Finlande ! Le seul article désagréable venait d’un journal local de ma région.
C’était ma première exposition personnelle. J’ai dû attendre 1958 pour la seconde chez Colette Allendy, et 1960 pour vendre ma première œuvre.
Mes 49 œuvres de 1949
C’est cette exposition, où l’on pouvait voir 33 de mes 49 œuvres de l’année 49, qui nous a décidés Kamel (qui n’a jamais peur des aventures un peu risquées) et moi à faire un catalogue raisonné et à exposer quelques pièces, sachant que cela donnerait plus de poids au titre de mon expo « FRANÇOIS MORELLET, C’EST N’IMPORTE QUOI ? »
J’avais en fait pratiquement oublié ces œuvres malgré l’importance de cette exposition chez Raymond Creuze.
Les œuvres de 1949 étaient absolument différentes de celles de 1948, qui elles-mêmes se rapprochaient plutôt de celles de 1950.
J’ai sûrement eu un peu honte par la suite et suis d’ailleurs quelquefois, encore aujourd’hui, un peu gêné devant ces cocktails qui, en fait, doivent correspondre un peu à ce que j’ai dû être, au moins pendant l’année 1949. Mais c’est en fin de compte amusant « d’être un peu n’importe quoi ». Et puis pour moi, il y a prescription. J’étais donc fier de ne pas aimer, entre autres, les professeurs, le Louvre, les cathédrales, les artistes de l’école de Paris et, en gros, ce que la génération de mes parents aimait. En revanche, et c’est plus positif, j’aimais les peintures de la grotte de Lascaux qu’on venait de découvrir, les tapisseries de l’Apocalypse d’Angers, les arts premiers en général que l’on pouvait voir au Musée de l’Homme à Paris et plus précisément les Tapas océaniens et les œuvres des aborigènes d’Australie et puis quelques sculptures africaines non identifiées.
En ce qui concerne l’art occidental du XXe siècle qui m’intéressait vraiment, je me souviens surtout de Pablo Picasso, Paul Klee, Jean Dubuffet, et puis bien sûr de deux amis artistes, François Arnal et Pierre Dmitrienko.
On peut s’amuser à trouver des traces du modèle original. Quelquefois c’est facile, par exemple quand on trouve des morceaux d’os et de tripes sur un animal, l’influence vient sûrement des aborigènes d’Australie.
Du côté des Tapas d’Océanie, ce sont des coups d’un tampon imprimant des segments de droites, un tampon assez semblable à celui que j’ai cru inventer en 2011.
Je reste encore aujourd’hui très étonné par le nombre élevé de ces œuvres. Il y a une raison qui peut paraître très paradoxale, c’est que 1949 c’est aussi la première année où je suis « rentré » dans l’entreprise familiale à Cholet (pour en sortir en 1976 !). En effet, en 1948 j’avais obtenu cette licence de russe à laquelle tenait tant mon père et qui m’obligeait les trois quarts du temps à rester à Paris. Et à Paris je n’avais pas d’atelier alors que j’en avais un dans ma maison près de Cholet. Et là, je pouvais « peindre » tous les soirs et les jours fériés. Je devais alors avoir une « fringale » de peinture que j’imagine mal aujourd’hui et qui brusquement s’est arrêtée en même temps que l’année 1949.
En effet, en 1950, l’année de l’exposition, j’étais revenu à une géométrie libre, puis, à la fin de l’année en décembre, je suis allé au Brésil pour préparer une émigration qui, en fait, n’a pas eu lieu. Et là, au Musée de São Paulo, une grande exposition de Max Bill m’a fait « entrer dans les ordres » ou plus exactement m’a converti à l’art concret où Van Doesburg et quelques autres avaient stipulé en 1930 que, pour avoir droit à l’appellation, l’œuvre devait être conçue avant d’être réalisée et que cette réalisation devait être précise, neutre, en utilisant des éléments de la géométrie. C’est ce que j’ai fait après quelques mois jusqu’à aujourd’hui. Il n’y avait heureusement aucune contre-indication en ce qui concerne l’humour.
Publié dans François Morellet, François Morellet, c’est n’importe quoi ? (cat. d’exp.) Paris, kamel mennour, 2014, 29 mars – 7 mai, pp. 8-9