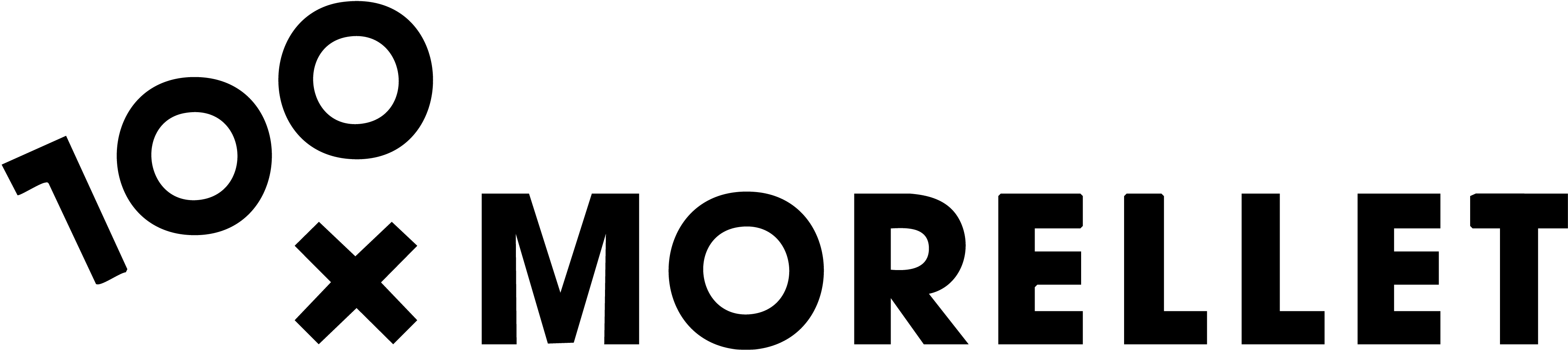Les années soixante-dix (1979)
Les années soixante-dix, en ce qui concerne ma peinture, ont été la suite directe des années 1950.
Pendant les années soixante, je me suis en effet surtout occupé de structures métalliques et de néons (et de participation des spectateurs avec le Groupe de Recherche d’Art Visuel).
Sans peur du ridicule, je vais jouer à l’historien d’art et essayer de disséquer en quelques lignes cette petite tranche de vie toute fraîche : 1970-1980.
D’abord, en ce qui concerne les œuvres.
—-– D’un côté, les trames des années cinquante, bien sagement parquées dans les limites de la toile, se sont mises à quitter leurs lieux de réunion traditionnels pour se répandre sur murs, fenêtres et autres sculptures qui se trouvaient sur leur passage (j’aurais bien sûr dû m’en douter, mes trames ayant toujours eu tendance à ne pas s’arrêter au bord du tableau).
—-– D’un autre côté, les tableaux sans trames, enfin vides, se sont mis à vivre leur propre vie, à se libérer de la dictature du parallélisme inconditionnel au mur et au sol. Cette liberté, il est vrai, s’arrête vite, soit devant le diktat d’une dernière ligne droite égarée, soit, comme toujours, devant des systèmes rigoureux, simples, évidents, précis et absurdes.
En ce qui me concerne, ce que je n’aurais pas peur d’appeler mes idées, la cassure avec les années 1950 et 1960 a été très nette.
Dès 1970-1971, ayant remarqué que l’amateur d’art éclairé donne un sens aux œuvres « sans tenir compte de ce que l’auteur a pu dire ou écrire, et souvent en opposition avec l’interprétation d’autres commentateurs… », j’en avais déduit (après maints détours, que je n’ai pas la place d’exposer ici) que « les arts plastiques doivent permettre au spectateur de trouver ce qu’il veut, c’est-à-dire ce qu’il amène lui-même. Les œuvres d’art sont des coins à pique-nique, des auberges espagnoles où l’on consomme ce que l’on apporte soi-même. . . ».
Maintenant, en 1979, je continue à fabriquer des œuvres faites pour ne (presque) rien dire. Mais je pense aujourd’hui que ce vide, cette non-signification, qui me fascine depuis trente ans, peut avoir une autre justification qu’un appel aux spectateurs et à leurs déballages de pique-nique.
En effet, si depuis 1950 mes œuvres flirtent avec le vide, c’est avec cette espèce bien particulière de vide dû à l’absence de « nature ». Absence voulue de toute évocation de la « nature », de toute justification « naturelle », de tout principe « naturel » (la « nature » n’ayant bien sûr rien à voir avec mes systèmes ou mon hasard systématisé).
Eh bien, une justification de ces œuvres « dénaturées », c’est d’être en accord avec un monde, comme je le conçois, « dénaturé » lui aussi, débarrassé de Dieu et de son résidu : l’idée de « nature ». C’est d’accepter un monde régi seulement par le hasard et l’artifice, d’accepter enfin un présent qui n’est plus refusé au nom d’un passé perdu ou d’un avenir à instaurer. C’est de tenter de réaliser un art « artificialiste » qui est aussi éloigné de l’art naturaliste que celui-ci a pu l’être de l’art sacré.
Et quand je parle d’art naturaliste, je n’entends pas bien sûr un art tendant à représenter exactement l’aspect du monde extérieur, mais un art qui veut faire croire que ses justifications sont autres que le hasard et l’artifice, qu’il est motivé par des forces mystérieuses venues des profondeurs de la nature, ou même des profondeurs de l’histoire (le sens de l’histoire étant le dernier avatar du naturalisme).
C’est entre autres, l’art de Mondrian qui voulait faire voir la nature « d’une manière plus pure », ou de Malevitch qui pensait que « l’homme est la nature » et que c’est l’homme maintenant qui va perfectionner cette nature pas assez naturelle.
Alors que pour moi, comme le dit Clément Rosset (L’Anti-nature, Presses Universitaires des France) : « il s’agit, en somme d’apprivoiser l’homme au sein d’un monde qui lui est aussi étranger que l’énigmatique « demeure inaccoutumée » dont parle
Empédocle dans un fragment de ses Purifications : de lui faire reconnaître comme « sienne » une absence de tout environnement définissable, de l’accoutumer peu à peu à l’idée d’artifice, en le faisant renoncer progressivement à un ensemble de représentations naturalistes dont l’absence de répondant dans la réalité n’a jamais manqué de conduire au désappointement et à l’angoisse ».
Publié dans Art Actuel, Genève, Annuel Skira, n° 6, 1980, p. 95 (extrait).
Repris et développé dans François Morellet (cat. d’exp.), Toulon, Musée de la Ville de Toulon, juin 1980, n. p.